Ce pays n’est pas pour ceux qui sont « dehors »
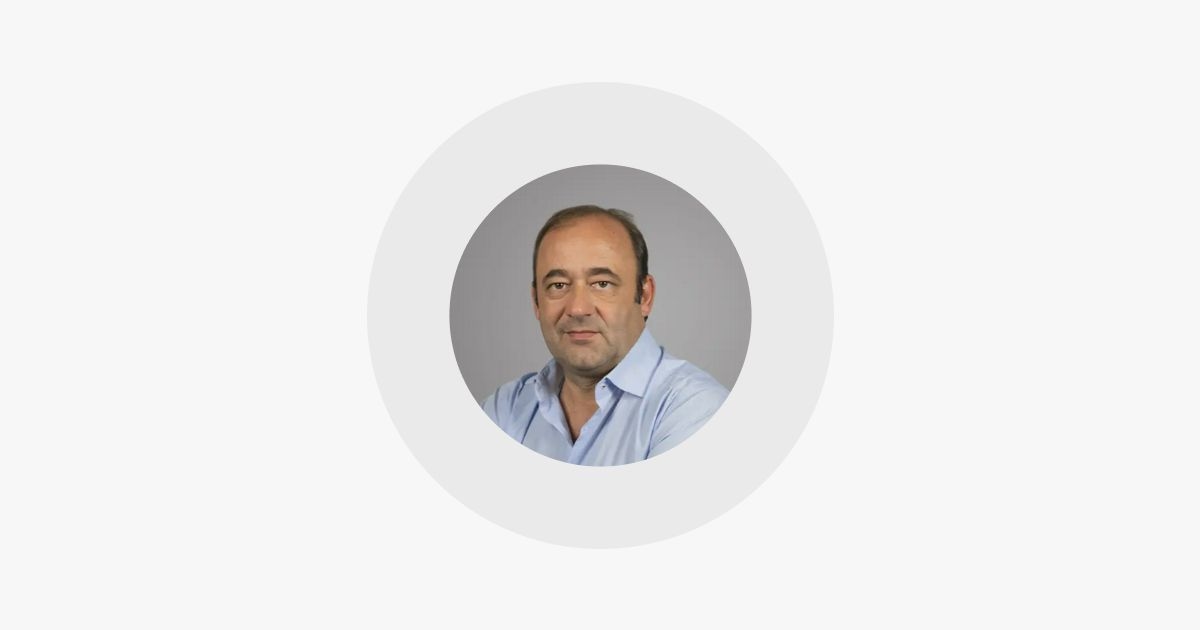
Il y a un peu plus d'un mois, une étude présentée au Forum de la BCE à Sintra indiquait que le Portugal était le deuxième pays européen où les salariés restent, en moyenne, le plus longtemps dans la même entreprise ; sans surprise, la Grèce arrive en tête. Un tiers des travailleurs portugais travaillent pour le même employeur depuis au moins 20 ans.
Restons-en à ces données sur le pays sans entrer dans le débat qui a animé la réunion des banquiers centraux sur la mobilité du marché du travail et sa relation avec l'écart d'innovation et de productivité entre l'Europe et les États-Unis.
Le pays où l’idée d’un « emploi à vie » pèse tant est en même temps le pays où l’accès au premier emploi est souvent précaire : CDD et reçus verts (vrai ou faux).
Il s’agit d’une dualité ancienne dans notre économie, dictée par la rigidité du marché du travail : ceux qui sont « dedans » sont protégés, et ceux qui sont « dehors » mais veulent entrer paient une partie de ce coût et de la faible dynamique qu’il engendre.
Au sein des entreprises, l'accès aux postes de direction et de management ne fait pas exception. Les données citées par Daniel Traça dans l'ouvrage « Ambition – Préparer le Portugal à la génération la mieux préparée » (Oficina do Livro, octobre 2024) – manifestations d'intérêt : j'ai collaboré avec Daniel Traça à la rédaction et à la relecture de l'ouvrage – montrent comment certaines générations « établies » freinent le renouvellement et l'arrivée de jeunes talents à des postes à plus grande responsabilité et à plus grande prise de décision.
Entre 2010 et 2021, l'âge moyen des cadres est passé de 44 à 48 ans dans les grandes entreprises et de 45 à 48 ans dans les entreprises de taille moyenne. Au Portugal, les cadres dirigeants travaillent dans le secteur depuis 30 ans en moyenne, soit le taux le plus élevé parmi les pays de l'Union européenne.
Un manque de renouvellement qui n’est pas étranger au fait que de nombreux jeunes préfèrent développer leur carrière à l’étranger, où le talent et le mérite sont davantage récompensés quels que soient les contextes comme l’âge.
Au cours de ce voyage à travers ce pays aux multiples facettes, nous pouvons également nous pencher sur le marché immobilier. La crise de la pénurie et des prix élevés est notoire, et nous connaissons bien les raisons qui nous ont conduits là : la rareté de la construction, la demande croissante et les interventions ou menaces politiques sur le marché locatif ou les droits de propriété.
Le problème est réel et grave, tant sur le plan économique que social. Cependant, sans que cela atténue le coût collectif de cette crise, la grande majorité de la population en bénéficie. Dans un pays où environ 70 % des familles vivent dans leur propre logement, la hausse des valeurs immobilières entraîne une augmentation du patrimoine de cette majorité de la population. Ce n'est pas un hasard si le logement représente déjà 55 % du patrimoine des ménages, et même 76 % pour les familles à faibles revenus.
Trois portraits d'un pays de plus en plus dualiste, semé d'obstacles à son propre renouveau, où les avantages d'être « dedans » et les coûts supportés par ceux « dehors » qui souhaitent y entrer sont de plus en plus évidents. Rigidité, hyperréglementation et culture de la défense de son propre « arrière-cour » entravent de plus en plus la dynamique économique et sociale exigée par notre époque moderne au rythme effréné.
observador





