Xénophon et la fermeture éclair
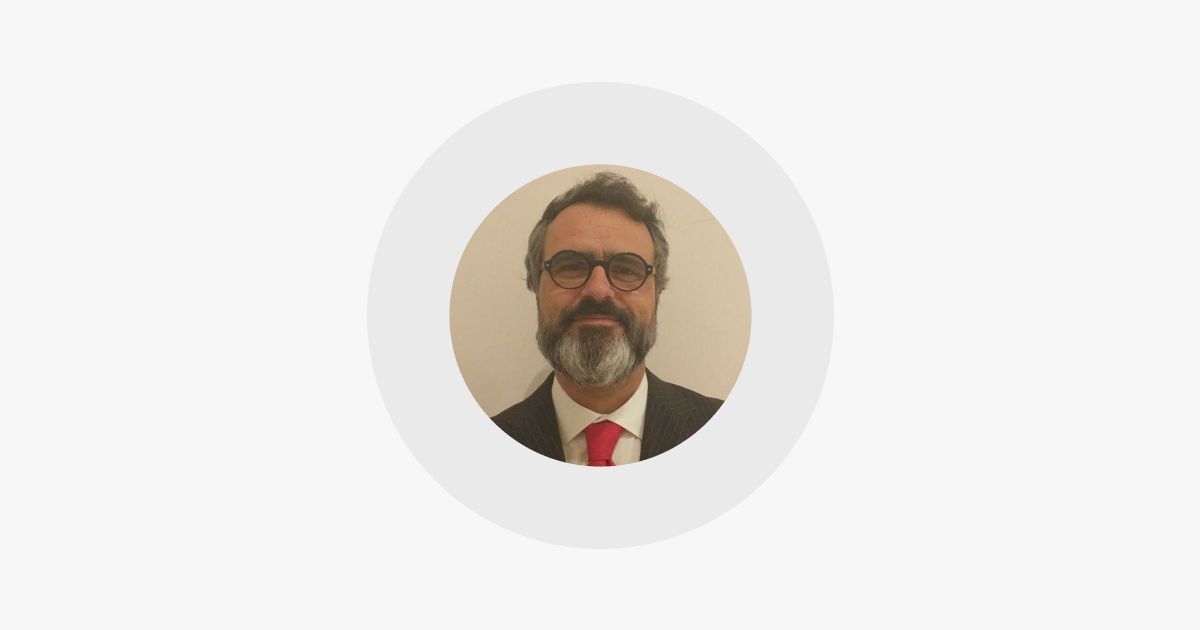
Un habitant de la Nouvelle-Angleterre inventa une extraordinaire encoche en métal doré à double tranchant et, pour la décrire, emprunta une comparaison à un éclair. Il dit : « Je l'appellerai une fermeture éclair . » Il s'appelait Whitcomb Judson. Il la mit en vente début 1891.
Homère et Pindare appelaient les fragments brisés des tesselles « symboles » lors du départ des héros. À leur retour des années plus tard, les héros en réajustaient les bords. Dès que leur pièce de puzzle s'emboîtait parfaitement dans l'autre, les yeux reconnaissaient les visages.
Comme la souris qui se fige, reconnaissant les dents du serpent qui hantent ses rêves de peur avant même qu'elle ne les perçoive réellement. Elle prend un air d'extase. C'est alors que la souris se transforme, sous les dents du serpent, en la forme de l'être autrefois plus grand qui l'attendait dans l'espace et qu'elle avait aperçu la nuit.
Après de nombreuses années, Xénophon en vint à croire qu'il valait mieux être mercenaire que soldat, même si pour être mercenaire, il fallait être soldat. Les mercenaires ont un caractère brusque et manquent généralement d'esprit de corps, contrairement aux soldats d'un royaume, dont la discipline, comme leur solde, vient de l'extérieur. Chaque mercenaire doit se débrouiller seul, pense plus à la vie qu'à la gloire et est libre d'improviser, tandis que les soldats sont subordonnés à une phalange ou à un escadron. Durant l'Anabase, et avant la bataille de Cunaxa, au cours de laquelle Cyrus mourut et où le commandement du chroniqueur grec fut révélé, Xénophon décida d'attribuer à chaque partie de son corps un fragment de mémoire et d'inscrire sur son corsage les chiffres et les lettres qui lui permettraient de revivre, s'il survivait à la fuite, les événements heureux et malheureux. La tromperie et la décapitation des généraux trahis furent regrettables, un événement qui découragea les leurs, qui furent momentanément décapités ; les retraites, les distractions d'Artaxerxès II et finalement la marche vers la mer Noire furent heureuses.
La nuit, les gardes prêts et les maigres provisions entamées, Xénophon lisait devant le feu les notes qu'il avait prises de ses conversations avec son maître Socrate. Elles étaient inscrites au revers de sa cuirasse et suivaient un système mnémotechnique basé sur des nombres et des mots. À l'aube, les dix mille hommes reprenaient leur marche, les pieds blessés, boiteux, obsédés par la perspective de sources d'eau douce et de provisions, perpétuellement rares. Ils traversèrent des vallées plus arides que les profondeurs de l'Hadès, des cirques de granit et de schiste craquelés par des étés brûlants, marchant des heures durant, sans un mot, le souffle court. Certains, plus grièvement blessés, périrent en chemin ; quelques-uns restèrent en arrière et proposèrent d'épier leurs poursuivants depuis les collines. Xénophon se multiplia : dès qu'il fut sur la place centrale de cette foule en fuite, il en prit la tête. Chaque fois qu'il pouvait s'adosser contre un acacia trapu et s'arrêter pour uriner un liquide sombre, épais et brûlant, il imaginait une bibliothèque abritant également des livres persans, car la connaissance de l'ennemi fait la force. Une petite bibliothèque, près de la mer, où il se consacrerait à retranscrire ses expériences de guerre et les cent détails que sa curiosité avait enregistrés au fil du temps : pierres à motifs spiralés, paillettes de mica, galets couleur de glace, vols d'aigles, cortèges de nuages, sources pauvres près desquelles poussaient des fougères phtisiques, éclairs, éclairs.
Il lui manquait la grâce et la mémoire de son maître Socrate, qu'il n'avait jamais vu citer ni livres ni documents. Le Maïeuta possédait la capacité d'improvisation, le don de jouer avec les idées, la patience de celui qui connaît le métier de sculpteur et, par conséquent, les manières de sculpter un bloc ou de peaufiner un argument. Xénophon lui devait l'art de la tempérance et le chemin pour chasser le désespoir. Dans la bibliothèque dont il rêvait, il y aurait peu, mais de beaux volumes. Pour les fugitifs, les nuits étoilées les emplissaient de l'espoir du retour, le berger avec ses chèvres, le paysan avec la terre grise, l'artisan avec ses bronzes, le vigneron avec ses vignes, le guérisseur avec ses onguents. Ils étaient les dix mille dans leur anabase, dans leur fuite. Ils remontèrent le Tigre et traversèrent l'Arménie par une route qui semblait sans fin. Ils atteignirent la colonie grecque de Trapezun, sur les rives de la mer Noire. À la vue de l'immensité des eaux et du clair de lune qui brillait sur les vagues, ils s'écrièrent : « La mer, la mer ! » écrirait Xénophon bien plus tard. Après quoi, ils tombèrent à genoux, invoquant leurs dieux : Xénophon, Artémis et Arès. Ils se frottèrent les paupières et caressèrent leurs chevilles douloureuses, crachèrent, sifflèrent et soupirèrent. Plus près de chez eux, à l'abri de leurs poursuivants, qui avaient entre-temps ralenti leur progression, des voix se réveillèrent : chants, insultes, bénédictions, serments et promesses. Établi à Skilunte, et avant de rejoindre la campagne d'Agésilas contre la Béotie, Xénophon tenta d'organiser sa petite bibliothèque, dans laquelle il commença à transcrire l'immense et prodigieux exploit auquel il avait participé et dont il avait été le principal contributeur. C'était comme étirer des sarments de vigne, dérouler du papyrus égyptien. Syllabes et chiffres coulaient au rythme de sa main, transcrivant l'héroïsme de l'un et le visage ensanglanté de l'autre. Ce serait une chronique, mais aussi une épopée. Ce serait un récit imprégné de la sueur et de la panique de ses hommes.
À la fin de 1891, le fermoir à dents de M. Judson avait trouvé onze acheteurs. En 1892, vingt-deux. En 1893, trente-trois. En 1894, quarante-quatre. En 1900, cent.
En 1909, à la mort de Whitcomb Judson, sa femme entra dans la pièce et il lui prit la main. Il la serra fort. Il lui demanda si elle se souvenait avoir imaginé, il y a plus de vingt ans, qu'en assemblant deux crochets dorés, l'un en face de l'autre, les dents ne se déchausseraient plus. Son invention n'était rien d'autre qu'un nom absurde évoquant la foudre et les orages.
Xénophon n'avait pas beaucoup de temps pour profiter de sa bibliothèque, car plus il se reposait et lisait, plus il était fatigué et plus il était appelé à sortir. Des jours durant, ses jambes lui faisaient mal et ses yeux baissaient. Lorsqu'il pensait à lui-même, il ne se voyait pas comme un mercenaire ou un voyageur, mais comme un ami de Cyrus le Perse, un disciple de Socrate, un enfant distrait et un écrivain accompli. Il répétait des mots persans au hasard, rêvait de mouettes. Il savourait le pain noir et l'huile d'olive où brillait la lumière de la liberté.
observador





