Géopolitique de l'islam politique en Europe
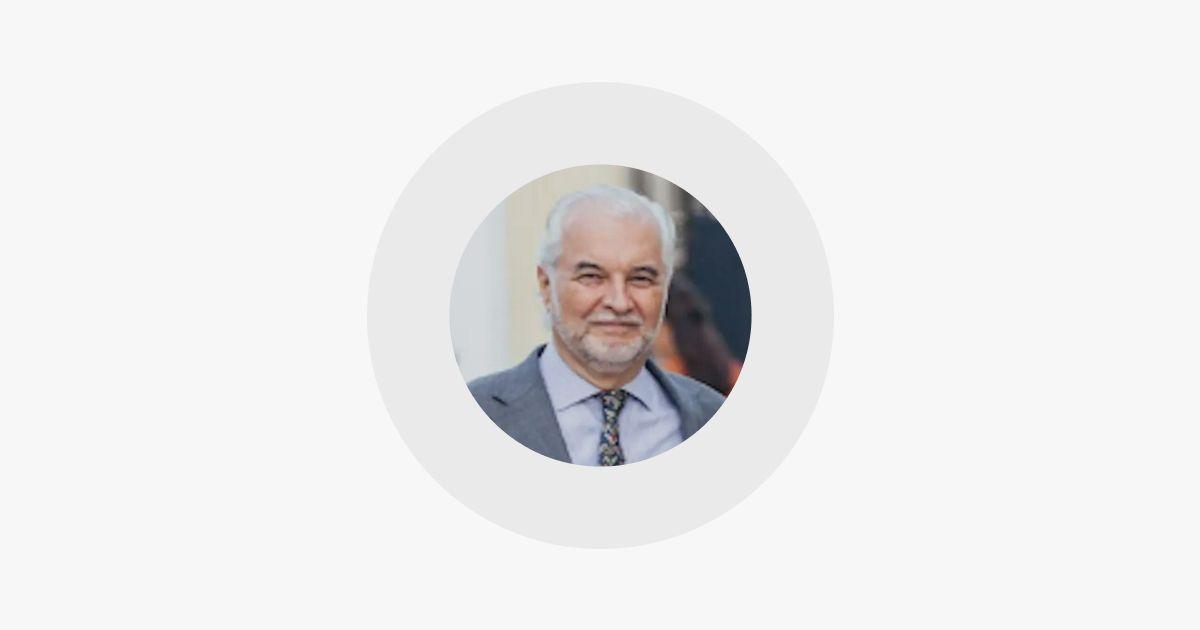
1 En France, un groupe de hauts responsables (dont le nombre et les noms n'ont pas été divulgués) a été chargé en avril 2024 par Emmanuel Macron, en sa qualité de président du Conseil national de défense et de sécurité – qui réunit les ministres de l'Intérieur, des Affaires étrangères et de la Défense – d' évaluer la sphère d'influence des Frères musulmans et de l'islam politique en France. « Cette mission devait formaliser, par une approche distincte des productions habituelles des services de renseignement ou de la recherche universitaire, un rapport qui mette en lumière la menace que représente l'entrisme islamiste pour la sécurité et la cohésion nationale. »
L’ entrisme (du français « entrisme ») est un terme technique désignant la tactique d’insertion organisée au sein d’institutions ou de mouvements existants – partis, syndicats, associations, conseils municipaux, écoles – dans le but d’influencer, de l’intérieur, leurs objectifs, leurs décisions et la répartition de leurs ressources, sans dévoiler publiquement le programme complet de ses promoteurs. Ce terme a été forgé dans les cercles trotskistes au XXe siècle pour décrire l’entrée de militants dans de grands partis afin de les réorienter. Son modus operandi typique consiste en une affiliation formelle, la conquête de postes secondaires, le contrôle de comités, l’élaboration de règles internes et la formation d’alliances de circonstance ; ce n’est qu’une fois le contrôle acquis que l’on tente de modifier l’orientation générale. L’entrisme se distingue du lobbying ou de l’infiltration, car ces derniers agissent de l’extérieur, en déclarant des intérêts, tandis que l’entrisme agit de l’intérieur, en recourant à l’opacité des objectifs et en opérant par des moyens légaux. L’« entrisme » opère au sein des institutions, généralement en respectant les règles formelles de l’organisation, mais avec un objectif stratégique distinct de sa mission initiale. Dans le contexte de l’islam politique, ce terme décrit des stratégies de présence prolongée dans les structures locales (associations, éducation, médiation communautaire, conseils consultatifs), visant à exercer une influence normative et à accéder à des financements, sans recourir à la violence.
L’originalité de cette étude française réside dans son approche : elle ne s’attache pas à diagnostiquer et analyser la menace terroriste islamiste, mais plutôt le risque d’influence légaliste et institutionnelle qui, agissant par des voies formelles – politico-associatives, éducatives et municipales –, sape la cohésion civique et la neutralité de l’État français. La mission s’est rendue dans quatre pays européens et dix départements français, où elle a interrogé plus de deux cents personnes (responsables de l’État, chefs religieux, universitaires, essayistes, élus, diplomates). Le rapport final, dans sa version publique de 75 pages intitulée « Les Frères musulmans et l’islam politique en France », a été publié le 21 mai 2025 par le ministère de l’Intérieur.
Selon le dossier de presse correspondant, « le rapport met en lumière une menace sérieuse, marquée par un double discours mêlant dissimulation et respect apparent des règles, visant à substituer à l’appartenance à la communauté nationale de nouvelles formes de loyauté rompant avec la tradition républicaine, et démontre la nécessité de sensibiliser le grand public et les décideurs publics à la réalité de cette menace. Sur la base des recommandations formulées dans ce rapport, le Conseil national de défense et de sécurité, réuni le 21 mai 2025, a présenté les premières orientations qui conduiront à la mise en œuvre d’un plan d’action national. » Le rapport « a été classifié afin de protéger des sources confidentielles. Il était également nécessaire de préserver le secret des procédures judiciaires en cours. La version rendue publique aujourd’hui est expurgée de ces éléments. »
La menace identifiée relève moins d'actes publics à fort impact que d'un processus cumulatif de reconfiguration institutionnelle. Par des moyens politico-associatifs, éducatifs et consultatifs, un droit souple local se crée qui, faute de contrôle, tend à se cristalliser en coutumes administratives et en « exceptions permanentes ». Il en résulte une érosion silencieuse des normes universelles – égalité de traitement, neutralité de l'État, impartialité dans l'allocation des ressources – accompagnée d'une mainmise sur des instances discrètes (commissions, jurys, conseils) où sont décidés les ordres du jour et les budgets. Ce déplacement du centre de décision vers des sphères opaques diminue la responsabilité et crée des dépendances fonctionnelles entre les pouvoirs publics et certains groupes d'entités.
Pour distinguer l’« influence légaliste/ l’entrisme » de l’exercice légitime de la liberté religieuse et associative, la mission a appliqué les critères opérationnels suivants : (i) finalité transformatrice non déclarée ; (ii) appropriation des instances et des ressources (comités, subventions, espaces publics) ; (iii) production répétée de droit souple local (avis/codes de facto). Exemples typiques : ségrégation des activités dans les établissements publics ; renouvellement des protocoles « temporaires » modifiant le règlement intérieur des écoles.
2 En Allemagne, la surveillance de l’islamisme suit encore la voie écartée en France : celle de la « production habituelle des services de renseignement », ou, en langage courant, des services secrets, qui se concentre principalement sur la menace terroriste islamiste, sans prendre spécifiquement en compte l’« entrisme », ce qui laisse supposer une méconnaissance persistante de ce phénomène dans ce pays. En pratique, la surveillance est menée selon une approche sécuritaire classique ; les aspects juridiques sont pris en compte, mais de manière non systématique, sans module spécifique consacré à l’« entrisme ».
Le rôle principal incombe au BfV ( Bundesamt für Verfassungsschutz ) , le service de renseignement intérieur placé sous la tutelle du ministère fédéral de l'Intérieur, chargé de surveiller et d'évaluer les menaces pesant sur l'ordre démocratique libéral (extrémisme de droite, de gauche et islamiste, espionnage, influence hostile). Le BfV publie un « Rapport annuel sur la protection de la Constitution », analysant les organisations à haut risque et les classant de « cas suspects » à « extrémistes avérés ». Le rapport de 2024 considère que la menace terroriste islamiste en Allemagne demeure élevée, estimant à environ 28 000 le nombre potentiel de personnes impliquées dans l'extrémisme islamiste, dont environ 9 500 sont susceptibles de commettre des actes de violence. À cela s'ajoute un niveau élevé de « criminalité à motivation politique – idéologie religieuse », incluant une part, certes faible mais non négligeable, d'infractions violentes. Le rapport met en lumière des plans impliquant de petites cellules et des individus isolés, souvent peu sophistiqués et exécutés rapidement grâce à la radicalisation en ligne . Au sein de ce phénomène, les groupes salafistes sont numériquement dominants ; parmi les écosystèmes structurés figurent Millî Görüş, les Frères musulmans/DMG (une organisation sous surveillance) et des acteurs interdits ou désignés comme le Hamas. Concernant le risque de propagation en Europe, la province du Khorasan de l’État islamique (EI-K) est identifiée comme la branche la plus importante de Daech.
Dans son rapport de 2024, l'Office fédéral de protection de la Constitution (BfV) notait que le parti « AfD – Alternative pour l'Allemagne » exprimait des « positions hostiles envers les étrangers et les musulmans », reflétant une conception ethno-ancestrale de la nation, et le classait comme un « cas suspect » de tendances d'extrême droite. Le 2 mai 2025, dans un nouveau rapport, le BfV requalifiait l'AfD en « extrémisme de droite avéré », dépassant le simple stade de la suspicion. Cette nouvelle classification, qui faisait l'objet d'un recours juridique, était annoncée par le gouvernement fédéral lors d'une conférence de presse de la ministre de l'Intérieur, Nancy Faeser.
3. Afin d’obtenir une vue d’ensemble européenne du phénomène de l’islam politique, une matrice comparative a été élaborée pour mesurer le risque d’influence « légaliste » et les tensions sociopolitiques qui y sont associées. L’analyse porte sur les aspects administratifs et sociétaux – l’entrisme institutionnel, la production de droit souple local et les pressions exercées sur les écoles et les municipalités – et se distingue de la menace du terrorisme armé. Les scores résultent de la consolidation de sources officielles récentes (rapports sur la protection de la Constitution et la sécurité intérieure, statistiques sur les crimes de haine, déclarations ministérielles et des coordinateurs nationaux), validées par recoupement avec des rapports européens, afin d’orienter les actions prioritaires et d’apporter une réponse proportionnée. Une bibliographie plus complète figure à la fin du texte.
- Pour chaque pays, la probabilité (P) et l'impact (I) ont été attribués sur une échelle de 1 à 5, avec le risque = P×I (certains scores étant ajustés au dixième près), avec un maximum théorique de 25 points (5×5).
- La colonne P prend en compte : (i) la mobilisation de rue/en ligne (30 %) ; (ii) les incidents haineux pertinents (25 %) ; (iii) les mesures administratives/dissolutions/interdictions (20 %) ; (iv) la densité organisationnelle/le regroupement local (25 %).
- La colonne I prend en compte : (i) les perturbations fonctionnelles dans les écoles/services/infrastructures (30 %) ; (ii) les pressions institutionnelles (litiges, avis « techniques ») (20 %) ; (iii) l’impact des médias nationaux (20 %) ; (iv) la violence/les confrontations lors des manifestations (30 %).
- Traçabilité : un tableau est joint pour chaque pays, présentant 3 à 5 variables → score (par exemple : nombre de manifestations > 50 000/an ; nombre de crimes haineux pour 100 000 habitants ; nombre de mesures administratives ; densité d’association ; audience des « prédicateurs 2.0 »). Un mini-test de résistance est également inclus (↑20 % d’incidents haineux ⇒ +0,2 dans le score P).
- Départage et transparence : les pays sont classés par R (P×I), puis par P et par I, avec P/I publié jusqu'au dixième.


4. La matrice met en évidence un noyau géographique à très haut risque de pénétration de l'islam politique en Allemagne, en France, en Belgique, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Autriche. Dans ces pays, la combinaison d'une forte mobilisation citoyenne, d'une polarisation mesurable (pics d'antisémitisme et d'islamophobie), d'écosystèmes associatifs denses et d'une réponse administrative active (inspections, dissolutions, interdictions) crée un environnement propice à une influence « légaliste » et à l'entrisme institutionnel. Trois à cinq indicateurs sont appliqués par pays (manifestations > 50 000/an ; crimes de haine/100 000 habitants ; nombre de mesures administratives ; densité associative ; audience hebdomadaire des prédicateurs « 2.0 ») et des ratios P/I jusqu'au dixième ordre sont adoptés, accompagnés d'un graphique de classement.
Dans un second cercle se trouvent l'Italie, l'Espagne, la Suisse et la Suède, où la pression résulte principalement de cycles de protestation et de perturbations sectorielles (campus universitaires, ports, transports), avec de fortes variations territoriales ; dans ce cas, l'impact est aussi important que la probabilité. Le niveau passe à « très élevé » lorsque P ≥ 4,2 et I ≥ 3,8 pendant au moins deux trimestres ; deux à trois villes sentinelles sont identifiées par pays (Milan/Rome ; Madrid/Barcelone ; Zurich ; Stockholm/Göteborg).
L’Irlande, la Norvège et le Danemark apparaissent comme des pays à risque moyen, avec une polarisation et des manifestations régulières, mais une densité organisationnelle plus faible et des perturbations fonctionnelles plus contenues, tandis que le Portugal, la Pologne et la République tchèque restent à des niveaux faibles à moyens, caractérisés par des structures juridiques moins denses et des épisodes principalement épisodiques – nécessitant toujours une attention particulière aux effets de démonstration et à l’importation de modèles.
5. La France est, en pratique, le seul État européen à avoir mis en œuvre un plan d’action national spécifique pour lutter contre le vecteur d’« influence légaliste/ entrisme » de l’islam politique. Le rapport susmentionné , Frères musulmans et islamisme politique en France, structure les recommandations opérationnelles qui constituent le fondement immédiat de ce plan : définir juridiquement le phénomène, produire une documentation publique régulière – rapports d’experts et d’universitaires, en complément du rapport annuel des services compétents – et donner aux décideurs (collectivités territoriales, administrations scolaires, gouvernement) les moyens de distinguer les pratiques religieuses légitimes des stratégies de récupération institutionnelle. Le rapport souligne également une dimension européenne et financière – sensibiliser les institutions de l’UE et collaborer avec le GAFI ( Groupe d’action financière , organisme intergouvernemental qui établit des normes mondiales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération, notamment sur le financement associatif) – et propose d’investir dans une « islamologie française contemporaine », complétée par des « signaux forts » de politique publique visant à réduire les zones grises : clarification des règles funéraires sur le territoire national, intégration de l’enseignement de la langue arabe dans les écoles publiques (au lieu de le sous-traiter aux réseaux d’origine) et un discours extérieur qui décourage l’instrumentalisation du conflit israélo-palestinien, tout en préservant les libertés fondamentales.
En termes de mise en œuvre, le plan issu du rapport se traduit par des mesures administratives proportionnées et non axées sur la sécurité : transparence du financement (bénéficiaire final et origine des fonds, audits), gouvernance et intégrité des comités de distribution des ressources publiques (rotation, déclaration d’intérêts, publication des critères et des procès-verbaux), contrats publics avec les écoles et les municipalités (accès universel, non-ségrégation, encadrement qualifié) et suivi public au moyen d’indicateurs simples de probabilité/impact assortis de synthèses accessibles. L’objectif est de préserver la neutralité de l’État et la cohésion sociale grâce à des instruments de bonne administration, en réservant la lutte contre le terrorisme à ce qui est, en réalité, du terrorisme.
Les autres pays européens devraient adopter des plans similaires, fondés sur les mêmes piliers : une définition juridique opérationnelle du phénomène ; une documentation et une formation ; un axe européen et financier ; des politiques publiques qui suppriment les incitations à la création de normes parallèles ; et un module de transparence et de responsabilité permettant un contrôle démocratique sans stigmatiser les communautés. Un tel alignement instaurerait une prévisibilité réglementaire et réduirait les asymétries entre les juridictions, écartant ainsi le repli sur soi juridique et évitant toute confusion entre la foi et le comportement organisationnel.
6. Il est également important de souligner l'asymétrie méthodologique entre la France et l'Allemagne. La première a adopté une lecture globale du vecteur légaliste/ entriste — avec des indicateurs de gouvernance, de contentieux, de droit souple local et de captation de commissions — tandis que la seconde reste ancrée dans un cadre sécuritaire classique, centré sur la criminalité à motivation politique, le terrorisme et l'extrémisme, selon les typologies traditionnelles du Verfassungsschutz (système allemand de protection de la Constitution qui comprend l'ensemble des services de renseignement intérieur surveillant les menaces à l'ordre libéral-démocratique).
Dans ce contexte, Berlin a privilégié la restriction et la surveillance des organisations d'extrême droite – dont l'AfD – selon une logique de « démocratie militante » compréhensible au regard de l'héritage nazi. Cette priorité peut toutefois engendrer un angle mort méthodologique : en concentrant les efforts institutionnels sur la maîtrise d'acteurs qui, dans certains contextes, contestent également l'entrisme légaliste, le système risque de sous-estimer, voire de détecter trop tard, la dynamique de l'influence islamiste non violente, comme la normalisation par précédent, le détournement de subventions et la mainmise sur certains processus décisionnels. Cette méthode réduit la sensibilité institutionnelle à cette dynamique d'influence légaliste islamiste.
Il en résulte trois effets : des perceptions des risques non comparables (l’approche française mesure le vecteur légaliste ; l’approche allemande l’isole à peine), des instruments inadéquats (une réponse pénale/antiterroriste à des phénomènes dont le levier efficace est administratif) et une « saturation sélective » qui consomme des capacités analytiques et du capital politique, tous deux nécessaires à la prévention précoce de l’entrisme islamiste.
Il est donc nécessaire d’introduire dans l’architecture de reporting allemande : (i) un module spécifique « légaliste/ entriste », (ii) de symétriser la surveillance – en maintenant la surveillance de la droite radicale mais sans la réduire à des positions sur les réseaux légalistes islamistes, identifiés dans le rapport français comme une « grave menace » pour la cohésion nationale, en « remplaçant l’appartenance à la communauté nationale par de nouvelles formes de loyauté qui rompent avec la tradition républicaine [française] », et (iii) de renforcer la transparence et la gouvernance des subventions et commissions municipales (rotation, incompatibilités, critères publics), en tirant parti des méthodologies déjà opérationnelles en France, en Autriche et en Belgique, afin d’harmoniser les seuils et les indicateurs de surveillance au niveau européen.
- EUROPOL — EU TE-SAT 2025 (rapport annuel), juin 2025. Aperçu des attaques, des détentions et des tendances dans l'UE (année de référence : 2024). [ PDF ] · [ Page du rapport ]
- OSCE-BIDDH — Données sur les crimes de haine (mise à jour annuelle, novembre). Portail et rapport méthodologiquement comparables ; séries par pays. [ Portail ] · [ Présentation 2023/24 ]
- FRA — Troisième enquête sur l’antisémitisme (UE) (juillet 2024). Perceptions et expériences des Juifs dans l’UE (avant et après le 7 octobre 2023, avec consultation complémentaire). [ Rapport ]
- MI — « Frères musulmans et islam politique en France » (dossier/version publique ; 21 mai 2025). Commission 2024 ; conclusions et orientations gouvernementales. [ Page officielle ]
- Loi n° 2021-1109 (24/08/2021) « pour le respect des principes de la République ». Cadre juridique pour la transparence associative, l’éducation et le financement. [ Legifrance ]
- BfV — Rapport sur la protection de la Constitution 2024 (Résumé, EN), 10 juin 2025. Cadre statistique et analytique par phénomène (dont l’islam). [ PDF ]
- BfV — Verfassungsschutzbericht 2024 (DE, version complète)** (10 juin 2025). [ PDF ]
- BfV (portail, EN)**. Rubriques thématiques (dont Islamisme/Terrorisme islamiste). [ Page d'accueil ]
- DSN — Rapport annuel de protection et de renseignement 2024** (mai-juillet 2025). [ PDF ] · [Page « Publications » du DSN] · [ Note BMI ]
- Contexte (cas de référence 2024, Vienne)** : tentative d’attentat à la bombe lors d’un concert de masse (indicateur de risque de l’UE). [ Reuters ]
- OCAM/CUTA — Rapport annuel 2024** (juin 2025). Niveau de menace et résumé des tendances (y compris les tensions de 2023-2024). [ PDF ]
- NCTV — Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN, juin 2025)** : niveau 4 (« substantieel ») maintenu ; modus operandi et cibles probables. [ PDF ] · [ Note du gouvernement ]
- MI5/ JTAC — Niveaux de menace terroriste (définitions et état)**. [ Page ]
- Ministère de l'Intérieur — Crimes de haine : Angleterre et Pays de Galles (année se terminant en mars 2024)**. [ Bulletin ]
- CST — Rapport sur les incidents antisémites 2024**. [ PDF ]
- Dites-le à MAMA — La nouvelle norme de la haine anti-musulmane (2025)** — Données consolidées de 2024. [ PDF ]
- DIS — Rapport annuel sur la politique d'information en matière de sécurité (2024)** (présentation le 4 mars 2025). [ Portail ] · [ Page 2025 ]
- Ministère de l’Intérieur — Déclarations relatives aux expulsions pour raisons de sécurité nationale (2024-2025)**. [ Exemple ]
- Ministère de l'Intérieur — Niveau d'alerte antiterroriste (NAA). [ Page officielle ]
- Moncloa — Renfort de niveau 4 (Pâques 2025). [ Note ]
- Observatoire de l'antisémitisme (FCJE) — Publications/Rapports. [ Page ]
- Troubles de Torre-Pacheco (juillet 2025) — Résumé gouvernemental. [Bulletin ( PDF )]
- Services gouvernementaux — Stratégie nationale contre l’extrémisme violent et le terrorisme (2024)** : prévoit notamment un examen du financement extérieur des entités liées à l’extrémisme. [ PDF ]
- Brå — Crimes de haine antisémites (2025)**. Données qualitatives et institutionnelles postérieures au 10 juillet. [Page](https://bra.se/english/publications/archive/2025-08-29-antisemitic-hate-crime) · [ PDF ]
- Conseil fédéral — Loi fédérale interdisant le Hamas (en vigueur depuis le 15 mai 2025)**. [ Déclaration ]
- PET/CTA — Vurdering af terrortruslen mod Danmark 2025** (DK et EN). [NSP ( PDF )]() · [EN ( PDF )]
- AKVAH — Incidents antisémites au Danemark en 2024**. [Rapport ( PDF )]
- PST — Évaluation nationale des menaces 2025 (EN)**. [ PDF ]
- An Garda Síochána — Date du crime haineux 2024**. [ Page ]
- RASI 2024 — Rapport annuel sur la sécurité intérieure** (publié en avril 2025). [ Portail officiel ]
- BRI — Rapport annuel 2024 (EN)**. [ PDF ] · [ Page des rapports ]
observador




