Don Quichotte, l'ironie et la tête d'Orphée
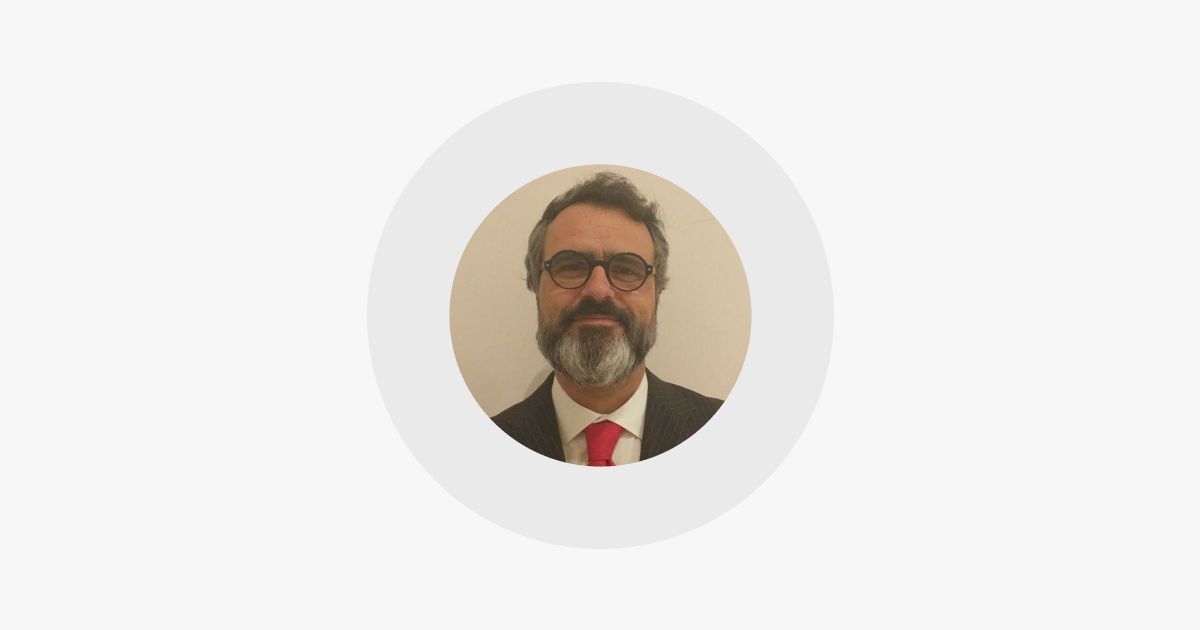
L'un de mes passages préférés de Don Quichotte se déroule dans la Sierra Morena : Don Quichotte saute par-dessus les rochers, imitant ces chevaliers, comme Amadis et Orlando, qui, rendus fous par la jalousie, se livraient aux actes les plus insensés. Sancho lui demande pourquoi il s'est comporté si inutilement, alors qu'il n'a aucune raison de se sentir méprisé par sa Dulcinée. Don Quichotte répond : « C'est là le point, et la subtilité de mon métier : pour un chevalier errant, devenir fou pour une cause n'a ni honneur ni grâce : le secret, c'est d'être fou sans cause. »
Cette « folie déraisonnable » est la clé du livre de Cervantès. Le dictionnaire définit la « folie » comme « folie, absurdité ou erreur ». Mais chez Cervantès, elle a un sens bien différent. Tels les gestes absurdes d'un maître zen, la folie de Don Quichotte a le pouvoir de suspendre momentanément le principe de réalité. Sa fonction est d'ouvrir une brèche dans la logique et de nous conduire à la compréhension profonde et immédiate d'une vérité nouvelle. Ainsi, entre les deux modèles auxquels il est confronté dans la Sierra Morena, celui d'Amadis et celui d'Orlando, Don Quichotte choisit sans hésiter le premier : Orlando, bouleversé par la trahison d'Angélique, modifie le cours des rivières, ravage les forêts et anéantit le bétail ; tandis qu'Amadis commet « une folie non pas de nuire, mais de larmes et de sentiments ». Tel est le chemin de Don Quichotte, pour qui l'aventure n'implique jamais une rupture avec la réalité, mais plutôt son exaltation. Elle est donc indissociable de la joie qui naît du fait de concevoir les choses non pas en termes de vrai ou de faux, mais d'épiphanie. La folie est une condition du paradis, car elle fait du monde un lieu de possibilités.
Cela n'a rien à voir avec la folie. La folie, c'est ne pas tenir compte des autres, et peu de héros les ont pris aussi au sérieux que Don Quichotte. La grande leçon de ses aventures est qu'un monde sans justice est sans valeur ; mais un monde sans miséricorde non plus, qui n'est rien d'autre que cette seconde chance que l'on donne aux choses pour qu'elles puissent enfin être ce qu'elles peuvent être. Don Quichotte est le chevalier de cette seconde chance, et c'est pourquoi peu de héros sont plus bavards que lui, car cette seconde chance se joue toujours dans le langage. Au point qu'on pourrait dire qu'il fait tout ce qu'il fait motivé par son désir de ne jamais cesser de parler, et que la parole elle-même – toujours trouver des choses à dire et quelqu'un à qui les dire – est sa raison d'être chevalier. Ainsi, à côté de ces noms qu'il assume si justement – Chevalier à la Triste Face, Chevalier aux Lions –, il aurait pu plus justement se nommer Chevalier de la Parole.
Mais il offre aussi son corps, celui que rejette la femme qu'il aimait le plus : il perd lances, boucliers, casques, pièces d'armure, et est frappé et blessé à maintes reprises. Rares sont les personnages de l'histoire littéraire qui ont laissé une telle trace, à tel point qu'on pourrait presque dire qu'il n'y a pas d'aventure dans laquelle il se lance sans laisser quelque chose de lui-même. Autrement dit, il ne se contente pas de parler. Quand son tour arrive, il en paie le prix. Et c'est là toute l'ironie : le chevalier qui multiplie les erreurs est aussi celui qui révèle finalement, par ses paroles et ses actes, tout ce qu'il y a d'indicible, de noble et de beau en nous.
L'ironie, pour Cervantès, c'est la capacité d'accepter les contradictions de la vie ; d'accepter, en bref, que rien n'existe d'une seule manière. C'est pourquoi Don Quichotte ne se lasse jamais de demander. Il demande aux aubergistes crasseux d'être des hôtes courtois ; aux pauvres servantes d'être mystérieuses et douces ; aux champs arides et stériles de La Manche de retrouver leur Âge d'Or, et au pot de chambre d'un barbier de se transformer en casque d'or. Sa force vient toujours de la conviction que le monde est bien meilleur qu'il ne l'est, comme si seul l'ignorance de la véritable nature des choses pouvait les transformer en ce qu'elles auraient dû être.
D'une certaine manière, Don Quichotte ressemble à Orphée, qui, grâce à son chant, fait s'arrêter les rivières, plier les branches devant lui et faire oublier aux animaux de brouter. Orphée sera déchiqueté par les Bacchantes, et le mythe raconte que sa tête continue de chanter, emportée par les eaux. Ni Don Quichotte ni Orphée ne cessent de prier, car ils aiment la vie si profondément qu'ils ne peuvent s'empêcher de se rebeller contre l'incomplétude de leur propre expérience. Quichotte veut transformer le monde en un beau livre d'aventures, et Orphée, par son chant, souhaite inventer un nouveau langage qui le rendra vivable. Rétrospectivement, c'est exactement ce que fait le lecteur : il accomplit cet acte suprême de prière qu'est la lecture, poussé par la nostalgie d'une impossible totalité. Il lit pour nier l'absurdité de la vie et parce qu'il ne veut pas que des choses comme la bonté, l'amour et le pardon disparaissent du monde.
Et en cela, les lecteurs ne diffèrent pas des enfants. Ils ne se lassent pas non plus de questionner : ils voient un miroir et demandent une porte vers un autre monde ; ils voient un vagabond et veulent recevoir de lui la carte d'une île perdue ; un oiseau passe par la fenêtre et ils demandent des nouvelles du jardin où les oiseaux parlent et les arbres chantent ; ils vont chez le boucher et s'arrêtent devant les têtes des agneaux sacrifiés comme s'ils leur chuchotaient leur triste histoire. Ce n'est pas qu'ils cherchent des choses ; ils les trouvent sans s'en rendre compte. Car il ne s'agit pas d'attendre des livres qu'ils nous livrent des vérités décisives sur la vie, mais de les lire sans savoir ce que nous espérons, si tant est que nous en attendions quelque chose. C'est pourquoi les bons livres sont inutiles. Ils ne nous aident pas à comprendre le monde, ils ne nous rendent pas plus sages ; mais ils nous plongent dans cet état de perplexité à la Cervantes.
Nous arrivons aux livres comme à des îles magiques, non pas parce que quelqu'un nous prend par la main, mais simplement parce qu'elles se présentent à nous. Lire, c'est, comme aimer, arriver à l'improviste dans un lieu nouveau. Un lieu dont, telle une île perdue, nous ignorions l'existence et dont nous ne pouvons prédire l'avenir. Un lieu où nous devons entrer en silence, les yeux grands ouverts, comme le font les enfants lorsqu'ils entrent dans une maison abandonnée.
Et, à ce stade, Don Quichotte nous tend toujours la main. Il nous enseigne qu'il existe deux sortes de menteurs : ceux qui se déguisent pour museler la vérité et ceux qui le font pour la suivre où qu'elle mène. Les personnages masqués des films et des bandes dessinées que nous adorions enfants appartenaient au second type. Ils se faisaient passer pour d'autres et, grâce à cette nouvelle identité, se rebellaient contre l'injustice, apportaient la joie aux malheureux et offraient leur nouveau corps à leur bien-aimé. Don Quichotte, le Chevalier de la Parole, est l'un de ces personnages masqués dont la folie a le pouvoir de donner des ailes à la vérité.
observador




