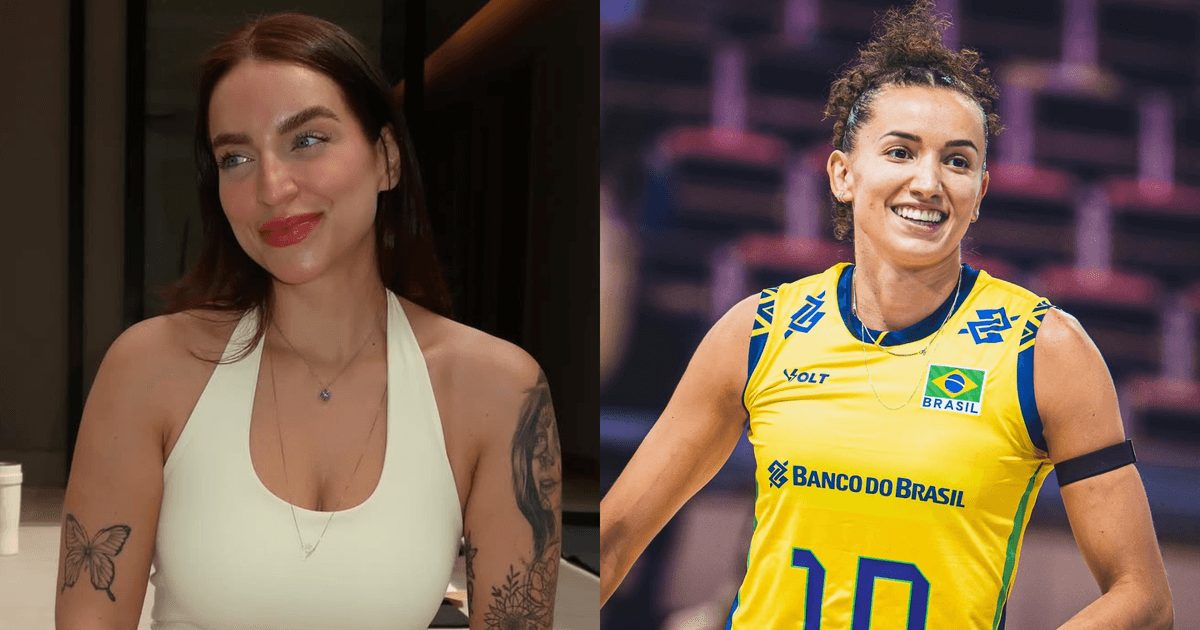L'étrange normalité budgétaire d'un pays indiscipliné.
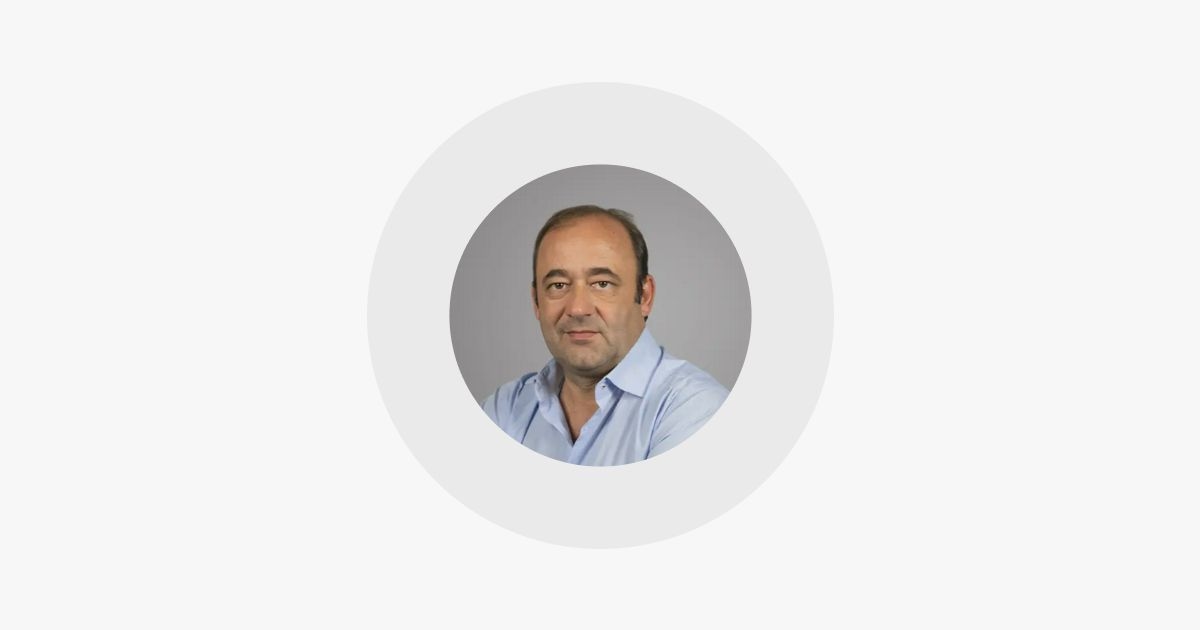
Il serait injuste d'affirmer que le pays ne procède pas à des réformes structurelles. Certes, il n'en réalise pas toutes les nécessaires, mais une réforme a été menée à bien ces quinze dernières années : le large consensus établi sur la nécessité d'anticiper et de réaliser l'équilibre des comptes publics, voire de légers excédents budgétaires.
Ce point de départ est désormais la norme dans les discussions budgétaires. Nous pouvons et devons discuter de l'affectation des dépenses et du montant des impôts à percevoir, mais sans modifier le solde final, qui doit être positif.
Ce processus a débuté en 2011 avec la mise en œuvre rigoureuse des conditions imposées par le plan de sauvetage financier, et s'est déjà poursuivi sous plusieurs gouvernements et dans différentes situations politiques.
Je reconnais que la manière dont nous sommes parvenus à cet équilibre ne constitue, au final, qu'une demi-réforme structurelle. Pourquoi ? Parce que cet ajustement n'a pas touché aux dépenses publiques courantes, qui augmentent structurellement d'année en année, et s'est fait exclusivement au moyen des variables les plus faciles à modifier : hausse des impôts et coupes budgétaires indiscriminées.
Néanmoins, l'établissement de l'objectif de « déficit zéro » représente un changement culturel majeur. C'est un principe car, comme nous le savons, notre mode de vie antérieur impliquait d'augmenter les dépenses, de relever les impôts et de créer d'importants déficits qui se sont transformés en dette. Jusqu'à ce que cela devienne intenable, et le reste appartient à l'histoire.
La différence entre avant et après le consensus sur l'équilibre budgétaire – obtenu, ironiquement, sous un gouvernement soutenu par l'extrême gauche – est frappante. Auparavant, le débat portait sur les impôts à augmenter ; aujourd'hui, il porte sur ceux à baisser. Auparavant, on tentait de masquer le déficit pour échapper aux sanctions de Bruxelles ; aujourd'hui, nous figurons parmi les pays de la zone euro dont les comptes sont les plus équilibrés. Auparavant, les plafonds d'endettement étaient testés selon l'idée reçue selon laquelle « la dette se gère, elle ne se rembourse pas » ; aujourd'hui, nous savons que les choses ne fonctionnent pas ainsi, et les ministres des Finances aiment afficher des ratios d'endettement toujours plus faibles.
Nous en sommes arrivés au point où un gouvernement peut être pénalisé en termes de popularité et de résultats électoraux s'il commence à accumuler des déficits sans raison valable – une pandémie, par exemple ? Nous ne savons pas, mais c'est un espoir qu'il faut nourrir.
Nous devons consolider cette dynamique car la prochaine étape impliquera inévitablement une réforme des dépenses publiques. Sans le déficit comme variable d'ajustement, et compte tenu de la forte pression fiscale actuelle, les ajustements futurs devront nécessairement rationaliser les dépenses publiques. Cela ne requiert pas de réductions nominales des dépenses. Il suffit que, d'année en année, les dépenses publiques augmentent à un rythme inférieur à celui de la croissance nominale du PIB.
C’est ce qui s’est passé avec la dette. Son montant augmente d’année en année, mais son poids dans une économie en croissance diminue progressivement.
À cette normalisation de l'équilibre budgétaire s'ajoute désormais celle du processus budgétaire. Le budget de l'État n'est pas, et ne saurait être, un vote de confiance annuel auquel les gouvernements minoritaires se soumettent. Il doit avant tout refléter financièrement les engagements de l'État et les lois en vigueur. La marge restante, relativement faible, doit ensuite tenir compte des choix politiques que chaque gouvernement opère au cas par cas.
Ces dernières années, nous nous sommes habitués à considérer le budget comme le seul événement législatif de l'année, où s'entassaient toutes les politiques sectorielles et des centaines de mesures isolées, n'ayant que peu ou rien à voir avec le budget.
Il y a un an, les partis politiques ont formulé environ 2 000 propositions d’amendements lors du débat budgétaire spécial. Parmi celles-ci : l’évaluation annuelle de l’état de santé des forces de sécurité, le gel de la privatisation de TAP (la compagnie aérienne portugaise), la promotion du travail des tisserands de tapis d’Arraiolos et des artisans de figurines d’Estremoz, la modernisation des modalités de paiement des demandes de contrôle des arrêts maladie, la révision du parcours professionnel des inspecteurs des impôts, etc.
Cette pratique a pour conséquence une qualité législative extrêmement médiocre – les membres du Parlement, lors de leurs longues séances marathon, ont accordé peu d'attention aux sujets sur lesquels ils votaient – et un manque de discussion indépendante sur chacune de ces propositions.
José Luís Carneiro a eu raison de conditionner la décision du gouvernement à l'inclusion dans le budget de questions importantes telles que la révision du droit du travail, les réformes de la sécurité sociale ou les modifications de la structure du Service national de santé. Ce sont là des sujets de grande importance qui ne peuvent que bénéficier d'un examen et d'une décision distincts du budget.
Et Joaquim Miranda Sarmento a eu raison de préparer et de présenter un budget qui, après tout, n'est rien d'autre qu'un budget. Nous étions tellement habitués aux mauvaises pratiques précédentes que nous sommes même surpris de voir chaque chose à sa place.
observador