La crise du logement et le prix de l'incertitude juridique
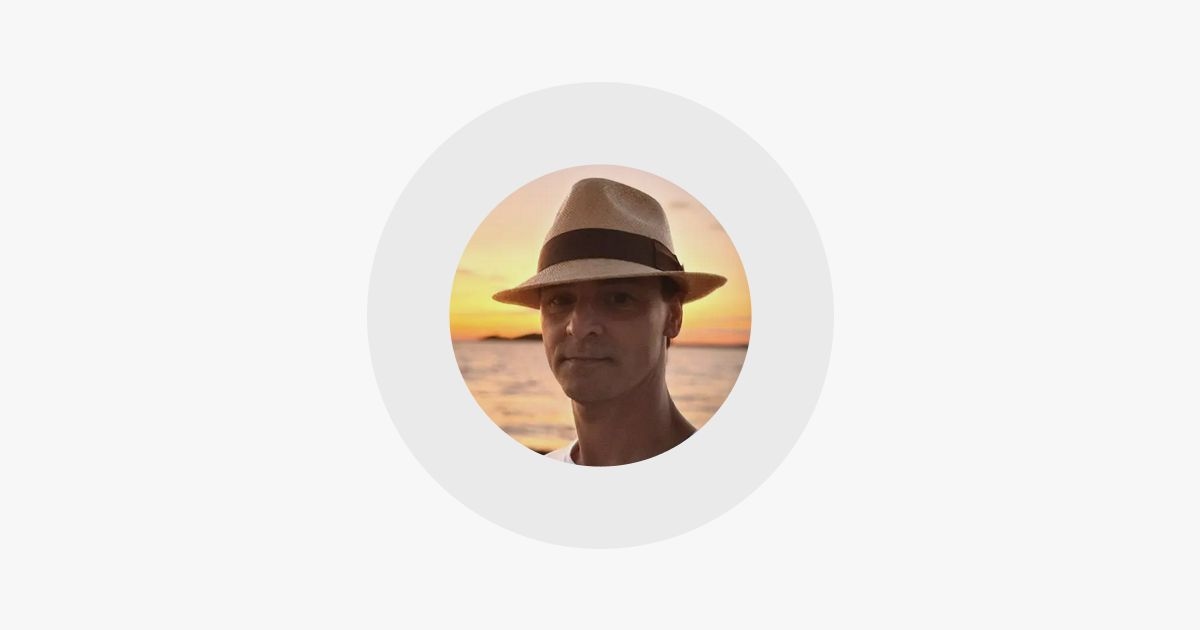
Pendant des années, le Portugal a cru que le problème du logement se résoudrait simplement en renforçant la protection des locataires. Le discours était simple et séduisant : les propriétaires avaient trop de pouvoir sur les locataires, et l’État devait intervenir pour rétablir l’équilibre. Le résultat est pourtant indéniable aujourd’hui : un marché locatif en contraction, des loyers prohibitifs et une méfiance généralisée entre propriétaires et locataires.
Les politiques de ces dernières années, notamment sous l'influence des gouvernements de gauche – la fameuse « geringonça » (coalition de gauche) – ont instauré un système où la bonne foi des propriétaires est constamment mise à l'épreuve et rarement récompensée. Les réformes législatives successives – présentées sous prétexte de « protéger les plus vulnérables » – ont fini par fragiliser le marché même qu'elles étaient censées préserver.
Le contrat de location résidentielle, qui devrait reposer sur la confiance mutuelle, est devenu un exercice juridiquement risqué. Le propriétaire qui loue un bien sait qu'en cas de défaut de paiement, il devra attendre des mois (voire des années) pour récupérer son logement, encourant des frais fixes et des pertes croissantes. Le locataire, quant à lui, sait que l'État est prêt à étendre sa protection quasiment sans limites, même en cas d'abus ou de défaut de paiement. Ce déséquilibre institutionnalisé a anéanti le principal facteur incitatif à l'offre : la sécurité.
Le résultat est paradoxal. En voulant protéger les locataires, l'État a fait fuir les propriétaires, réduit l'offre et, par conséquent, fait grimper les loyers. Face à l'augmentation du risque et à l'obstacle que représente la loi pour récupérer son bien, nombreux sont ceux qui renoncent à louer ou ne louent qu'à des prix compensant le risque. D'autres retirent leurs biens du marché et se tournent vers la location saisonnière, ou les laissent tout simplement inoccupés – conséquence prévisible d'une politique qui a confondu protection et sanction.
La réduction des indemnités pour retard de loyer, de 50 % à 20 %, illustre parfaitement ce renversement de logique. Dans un pays où le non-respect des obligations est presque considéré comme un droit acquis, l'exécution du contrat est devenue un choix moral, et non une obligation légale. La loi, censée garantir la prévisibilité, en est venue à récompenser la négligence et à sanctionner le respect des engagements.
La crise du logement est donc bien plus qu'une simple question de prix. C'est une crise de confiance. Sans confiance, pas d'investissement ; sans investissement, pas d'offre ; sans offre, pas de solution. Le problème n'est pas le « libre marché », mais un marché entravé par des règles qui traitent le propriétaire comme un suspect et le débiteur comme une victime.
Si le Portugal souhaite véritablement résoudre sa crise du logement, il doit faire ce qu'il a longtemps évité : rétablir la sécurité juridique et rééquilibrer le contrat de location. Il ne s'agit pas d'abandonner la protection sociale, mais de reconnaître que la stabilité du système repose sur ceux qui prennent des risques financiers. L'État ne peut continuer à exiger davantage de logements sur le marché tout en transformant le marché locatif en un véritable labyrinthe d'incertitudes et de bureaucratie.
En fin de compte, le problème n'est pas tombé du ciel — il a été construit, brique par brique, par les politiques mêmes qui visaient à instaurer un marché du logement équitable.
observador





