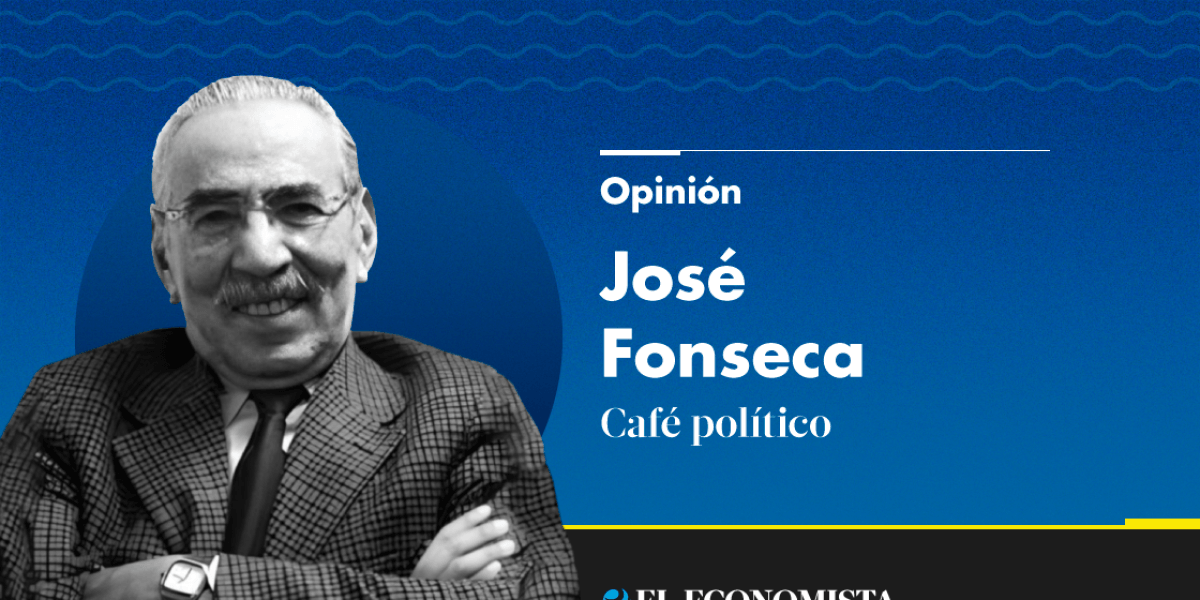Reconnaître la Palestine : un geste symbolique, tardif et sans effets réels

Interrogée hier, 22 septembre, sur la récente reconnaissance de la Palestine par le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et le Portugal, la présidente Claudia Sheinbaum a rappelé que le Mexique la reconnaissait depuis 2012 et continuerait à promouvoir une solution à deux États basée sur les frontières de 1967.
Avec cette décision, ils rejoignent l'Espagne, qui a officialisé sa reconnaissance en 2024, et la France, qui le fera du jour au lendemain. Cela reflète une division croissante de l'Occident envers Israël et marque une distanciation par rapport aux États-Unis, qui insistent pour que tout reste dans le cadre de négociations bilatérales.
L'origine du conflit israélo-arabe explique la difficulté de trouver une solution. La résolution 181 de l'ONU, qui proposait en 1947 la division de la Palestine en deux États, a immédiatement provoqué des affrontements. En décembre de la même année, des attaques ont eu lieu à Aden (Yémen) et à Alep (Syrie), tuant des dizaines de Juifs. En Palestine sous administration britannique, la guerre a éclaté entre milices juives et arabes. Quelques mois plus tard, en 1948, Israël a déclaré son indépendance et a été reconnu par les grandes puissances. Du côté palestinien, plus de 700 000 personnes ont été expulsées de ce qui avait été leur foyer ancestral.
Depuis lors, par leur veto au Conseil de sécurité de l'ONU, les États-Unis bloquent toute avancée vers un État palestinien. En avril 2024, ils ont bloqué son admission pleine et entière à l'ONU. De plus, Donald Trump, poussé par ses intérêts économiques, est perçu par ses détracteurs comme une marionnette du Premier ministre Benjamin Netanyahou.
Pas plus tard qu'hier, Netanyahou a qualifié ces reconnaissances de « récompense au terrorisme » et a réaffirmé qu'il n'autoriserait jamais la création d'un État palestinien à l'ouest du Jourdain. Il propose même une annexion partielle de la Cisjordanie. Parallèlement, il est accusé de terrorisme d'État et de génocide à Gaza. Mercredi dernier, le Brésil a rejoint l'Afrique du Sud, le Chili, la Colombie, Cuba, l'Espagne, l'Irlande, le Mexique et la Turquie devant la Cour internationale de Justice pour accuser Israël de génocide. Hier, la présidente a réaffirmé que la position de son gouvernement était de « mettre fin à ce génocide à Gaza… et qu'il ne pouvait y avoir d'agression contre la population civile comme celle qui se déroule actuellement ».
Dans le conflit actuel, le coût humain est insupportable. L'attaque brutale du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 a fait 1 195 morts et 251 otages enlevés. La riposte israélienne a causé plus de 65 000 morts à Gaza, en majorité des civils. Selon l'ONU, entre 54 et 70 % sont des femmes, des enfants et des personnes âgées. Ce nombre disproportionné est évident et a suscité une condamnation internationale, sans toutefois que de véritables sanctions soient prises contre Israël.
Le Mexique a maintenu une position constante : en 1947, il s’est abstenu de voter sur la partition, en 1950, il a reconnu Israël et, en 2012, il a soutenu l’octroi à la Palestine du statut d’État observateur à l’ONU. Aujourd’hui, il insiste sur la solution à deux États et sur Jérusalem-Est comme capitale palestinienne.
Le problème est que chaque année, cette solution s'éloigne davantage. Les colonies israéliennes se multiplient en Cisjordanie, et les morts, là-bas comme à Gaza, se multiplient. La reconnaissance occidentale arrive trop tard et ressemble davantage à une tentative de sauver la face des gouvernements restés silencieux face à la dévastation à Gaza qu'à un véritable pas vers la paix.
Pour l’instant, la Palestine est un État reconnu dans les discours, mais sans territoire, sans souveraineté, ni avenir clair pour son peuple.
Facebook : Eduardo J Ruiz-Healy
Eleconomista