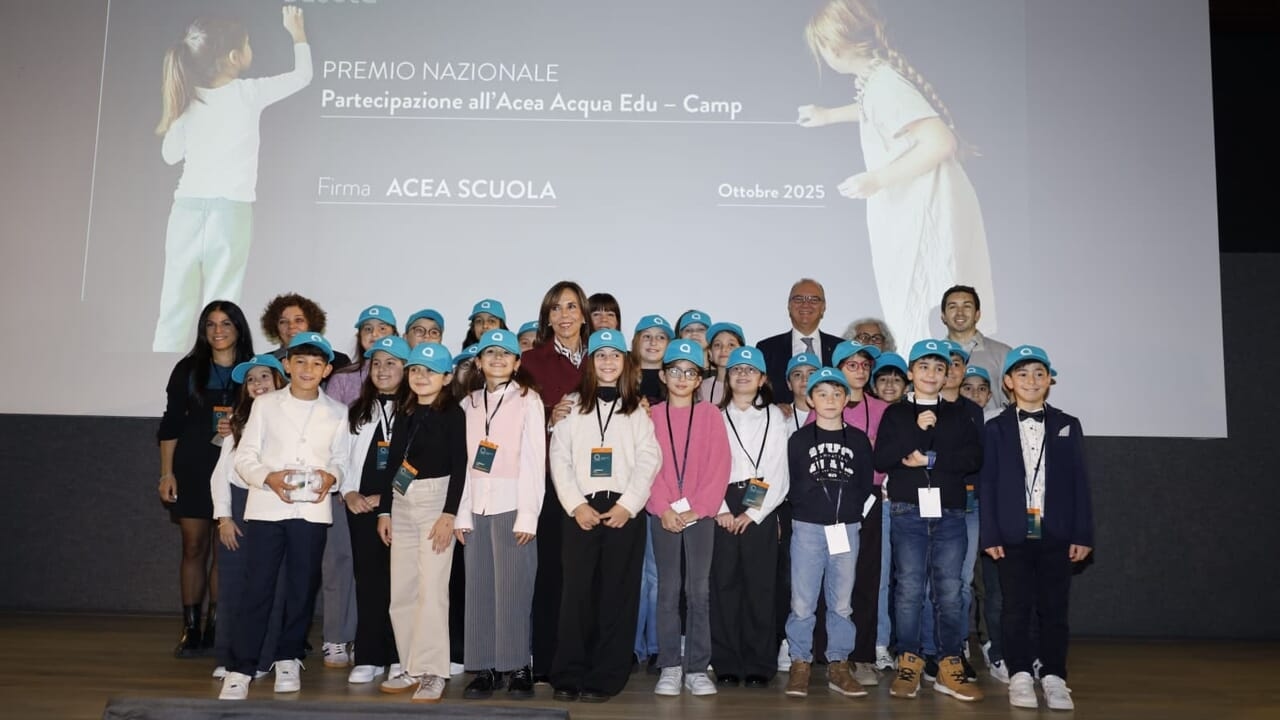Est-il vraiment nécessaire d'insulter les femmes pour faire du bon rap ?

Provocation, colère, rimes incisives. Dans le rap , le langage cru n'a jamais été un simple ornement : il fait partie intégrante de son identité , de son ADN de genre subversif. Il est souvent au cœur du débat public italien : le soir du Nouvel An dernier, par exemple, le trappeur Tony Effe a été interdit de concert à Rome en raison de ses paroles misogynes. Et récemment, il est revenu sur le devant de la scène suite à une affaire de violence née de paroles et devenue réalité : le jeune rappeur Faneto a été dénoncé par son ex-petite amie pour menaces et agression.
Ces épisodes ne sont pas des exceptions, mais les symptômes d'un problème plus profond concernant le rapport entre le rap et la représentation de la féminité . Depuis ses origines, le langage du rap a fait de la provocation et de la violence sa force, mais aujourd'hui, cette même force risque de se retourner contre les autres, de se transformer en une misogynie normalisée. Ce qui était autrefois un outil de dénonciation sociale est devenu, dans bien des cas, un langage de pouvoir , réduisant les femmes à des cibles ou à des trophées. Pour comprendre comment cette distorsion s'est produite, il faut se pencher sur l'histoire du rap italien – ses racines et ses transformations.
Une brève histoire du rap italienLe langage cru et violent est l'une des caractéristiques stylistiques les plus reconnaissables du rap ; il est né dans des contextes marginalisés marqués par la pauvreté, la discrimination et la colère sociale, comme une forme d' expression authentique pour une partie de la population « sans voix ». Les mots durs ne sont pas gratuits, mais ils représentent un moyen de redonner une authenticité aux expériences de marginalisation que la société a tendance à ignorer.
En Italie, le genre a d'abord conservé son caractère underground et subversif, où un langage violent et vulgaire remettait en question les tabous en vigueur et mettait en lumière les contradictions de la société. Le rap a émergé dans notre pays dans les années 1990 comme une forme d'expression culturelle dans les périphéries urbaines. Des artistes tels que Sangue Misto, Colle der Fomento, Frankie Hi-NRG MC et Assalti Frontali ont utilisé le rap comme un outil de commentaire social, abordant des problèmes tels que l'inégalité, la criminalité et la marginalisation.
Avec l'aube du nouveau millénaire, le rap italien a connu une transformation majeure. L'émergence de concours comme Tecniche Perfette et 2TheBeat, conjuguée à la diffusion d'internet et de plateformes telles que MySpace, a contribué à l' essor commercial du genre. Des artistes comme Club Dogo, Clementino et Fabri Fibra ont commencé à accéder à un succès grand public , adaptant leurs textes et leur imagerie pour toucher un public plus large. Lorsque le genre s'est commercialisé, les textes, les éléments stylistiques et les références culturelles sont restés les mêmes, mais leur fonction a changé. Fondamentalement, on a assisté à un glissement de l'affirmation collective vers une riposte sociale personnelle, le langage du rap devenant un outil d'affirmation de soi.
Avec l'avènement des réseaux sociaux et l'immense popularité des jeunes rappeurs et trappeurs , qui dominent les charts , la frontière entre artiste et personnalité publique s'estompe. De nouveaux rappeurs et trappeurs italiens, tels que Sfera Ebbasta, Capo Plaza et Baby Gang, mais surtout Anna, Glocky et Tony Boy, construisent leur image sur des plateformes comme Instagram et TikTok, où ils partagent des aspects de leur vie privée et professionnelle. Presque constamment sous le feu des projecteurs , qui les suivent à travers des profils de réseaux sociaux sans cesse mis à jour et interconnectés, l'artiste doit presque incarner son rôle , et non plus seulement le représenter lors de ses performances artistiques. Le personnage créé dans les chansons n'est plus dissociable de l'identité de celui ou celle qui les chante.
Un langage violent et misogyne comme marque de fabriqueDans le rap contemporain, la violence verbale symbolique s'accompagne souvent d' un langage misogyne et sexiste , ce qui a valu au genre de vives critiques de la part du public. Des termes vulgaires et offensants sont fréquemment utilisés, tant en italien qu'en anglais, pour désigner les femmes en général (à l'exception des mères des rappeurs, qui, dans la dernière génération d'artistes, occupent une place centrale dans le récit et sont totalement idéalisées).
Souvent, le discours véhiculé dans les chansons des artistes hip-hop réduit les femmes à un objet sexuel (« Au lit, j'ai une Roumaine avec des fraises et de la crème / Et je pourrais avoir un enfant avec elle, mais je ne lui donne qu'un coup de sperme », 'Tip Tap' de Papa V, Nerissima Serpe et Fritu) et qui représente un statut (« Baisons tes femmes / Et violons tes rythmes », 'Senicar' de Marracash et Guè).

Les femmes dont il est question sont souvent réduites à des conquêtes et, à l'instar de l'argent, servent à illustrer l' ascension sociale du rappeur. Dans d'autres cas, elles sont instrumentalisées pour rabaisser autrui et offenser (« Ta copine en jupe ressemble à un Écossais », « Fellini » d'Ernia et Kid Yugi). À cela s'ajoute parfois le racisme et la fétichisation des femmes racisées (« Qui s'en soucie si elle parle comme une Sénégalaise ? / Ah ahah, écoutez-la ! », mais aussi « Je ne la veux pas blanche, suédoise, malmö / Si elle n'est pas déjà mate, elle ira faire des UV », « Senicar » de Marracash et Guè).
La sexualité féminine est largement dévalorisée : les femmes dont il est question n’ont aucun pouvoir d’action, et lorsqu’elles en ont, c’est de manière négative. En bref, une vision qui s’accorde parfaitement avec la culture de la possession. Dans les pires cas, des violences sexuelles sont décrites dans les paroles, comme dans la chanson « Non è easy » du rappeur Shiva : « Si la fille ne veut pas le faire, si mes parents la baisent, ce sera mauvais pour elle parce qu’alors ils seront six à la baiser. »
Mais s'agit-il vraiment d'un genre aussi misogyne ?Il est important de souligner que le rap ne s'oriente pas entièrement dans cette direction, mais la misogynie demeure un élément récurrent et problématique dans de nombreux morceaux à succès, notamment auprès du jeune public. Une étude de 2025 menée par Lara Della Schiava , portant sur un vaste corpus de chansons d'artistes rap actifs sur la scène musicale actuelle, le démontre. Publiée dans la revue Lingue e Culture dei Media , l'étude conclut qu'« environ un tiers des paroles contiennent des expressions misogynes , avec une prédominance de termes dénigrants et de références sexualisantes », et que ces caractéristiques accompagnent le genre de manière constante depuis les années 1990 jusqu'à nos jours.
Della Schiava note également une « corrélation directe entre le niveau de misogynie dans les paroles et la popularité des artistes », et une tendance contre-intuitive révélée par l'étude est très intéressante : « Les chansons d'amour à connotation positive contiennent une fréquence plus élevée de termes désobligeants que celles à récit négatif, ce qui suggère une utilisation normalisée des expressions sexistes, même dans des contextes émotionnels. » En particulier, les références à la violence sont très présentes dans les paroles qui évoquent des relations brisées.
Responsabilité artistique et liberté d'expressionComme mentionné précédemment, le rap est un genre né en marge de la société et, dès ses origines, il a incarné l'idée de provocation, de transgression des tabous et de subversion des normes sociales. Un langage violent et vulgaire est resté la marque de fabrique de la majeure partie de la scène italienne depuis ses débuts. Parmi les cibles de ces termes injurieux et offensants figurent l'État et son pouvoir , parfois incarnés par ses représentants ou la police, mais aussi les classes sociales aisées, des personnalités, des rappeurs rivaux et, bien sûr, les femmes – qu'elles soient réelles ou considérées comme une catégorie générique.
Cependant, lorsque le rap devient un phénomène de masse, la portée symbolique de son langage se modifie et la liberté d'expression des artistes se trouve confrontée à certaines responsabilités . Que se passe-t-il lorsqu'un genre né des opprimés devient populaire et que l'une de ses cibles – en l'occurrence, les femmes et les filles – n'est pas l'oppresseur, mais une autre minorité ? La satire et la provocation cessent d'être libératrices et risquent de se transformer en abus .
Autrefois, le rap était le cri d'une minorité ; aujourd'hui, c'est un langage dominant, capable de façonner les comportements et l'imaginaire collectifs . De ce fait, la portée symbolique de ses paroles évolue : elles ne sont plus de simples « coups de gueule » d'une sous-culture, mais risquent de devenir des modèles à suivre.
Il ne s'agit pas de demander aux artistes de s'autocensurer, mais plutôt de les amener à prendre conscience de leur propre responsabilité communicationnelle, qui s'accroît avec le pouvoir des médias. Car les jeunes rappeurs d'aujourd'hui ne sont pas seulement des artistes, mais de véritables icônes médiatiques . Et il est important de souligner qu'il ne s'agit pas d'une responsabilité individuelle, mais partagée : avec les maisons de disques, les managers, l'industrie…
Est-il vraiment nécessaire d'insulter les femmes pour faire du bon rap ?Mais qu'apporte le langage misogyne au genre ? Il ne s'agit pas de briser les tabous ni de subvertir. La misogynie n'est pas un langage de rébellion ou de liberté, mais un langage de pouvoir , parfaitement en phase avec la culture dominante. Les « marginaux » ou les rebelles – ou ceux qui se présentent comme tels – qui l'adoptent finissent par reproduire une partie du système qu'ils cherchent à fuir. Il en va de même pour le rapport à la richesse : ceux qui viennent (ou prétendent venir) de milieux défavorisés ne dénoncent plus l'inégalité, mais célèbrent leur propre réussite individuelle.
Derrière cette violence symbolique se cache souvent une réalité plus sombre. Une mise en scène précise de la masculinité : le besoin d’afficher force, maîtrise, virilité. Pourtant, le rap, de par sa nature linguistique et performative, est aussi un espace où ces modèles peuvent être réinventés.
Authenticité et performance : le pouvoir transformateur des motsLe rap est un genre qui, depuis ses origines, a toujours eu une forte connotation masculine , même si cette tendance évolue lentement. Traditionnellement, il met en scène des démonstrations authentiques de masculinité : virile, agressive et compétitive . L’image du rappeur coïncide avec celle d’un homme dominant et conquérant, ne montrant aucune faiblesse. Dans ce contexte, le machisme n’est pas l’exception, mais la norme implicite du langage.
Cependant, les codes mêmes du rap – la mise en scène, l'exagération, la théâtralité – offrent aussi la possibilité d'une réécriture . Si la masculinité est une performance, alors elle peut être réinterprétée, ironisée, voire inversée. Certains artistes en sont conscients et jouent avec leur image publique. C'est le cas de Fabri Fibra , qui, sous son alter ego Mister Simpatia, construit un personnage délibérément extrême, arrogant, sexiste et violent : un masque qui pousse les stéréotypes du genre à l'extrême, jusqu'à la caricature.
Ces dernières années, de nouvelles voix – notamment des artistes femmes et queer – utilisent les mêmes outils linguistiques que le rap pour renverser les structures de pouvoir, s'appropriant cette force expressive afin de véhiculer une autre conception de l'identité et de la liberté. Le rap, d'un langage de domination, peut ainsi devenir un langage de libération et d'introspection. Nayt , lui aussi, s'inscrit dans cette perspective, interrogeant la notion de « masculinité » aujourd'hui dans son album « Un uomo ». Partant du constat d'une éducation masculine toxique – fondée sur le déni des émotions et la marchandisation des sentiments –, l'artiste analyse comment la violence devient souvent le dernier recours pour exprimer une masculinité fragile et en crise.
Dans un milieu où de nombreux rappeurs éprouvent le besoin d'afficher force et invulnérabilité, Nayt choisit la vulnérabilité comme forme de courage : il utilise la dimension introspective du rap pour soulever des questions, plutôt que d'apporter des réponses définitives. Ainsi, le genre retrouve sa puissance originelle : celle de donner la parole à ceux qui, en un sens, n'en ont jamais eu – pas même au fond d'eux-mêmes.
Donc, on n'écoute plus de rap ?Le rap demeure avant tout un miroir de la société : il reflète les contradictions, les désirs et les blessures collectives. C’est précisément pour cette raison qu’il s’agit d’un genre si riche de sens, qui mérite une écoute attentive et critique. Dans un contexte où la provocation est souvent confondue avec la liberté, il est essentiel de distinguer la dénonciation de l’apologie, la représentation de l’imitation. Raconter la violence ne signifie pas nécessairement la glorifier, mais ignorer les différences risque de la banaliser.
Le rap, par sa puissance linguistique et performative, nous invite à nous interroger : qui parle, qui est représenté, et quelle société produit et consomme certaines images ? Point besoin de le censurer, mais plutôt d'apprendre à le décrypter – à en discuter, à le remettre en question, à nous reconnaître (ou non) dans son message. L'écoute devient ainsi un acte politique et culturel : non pas un geste passif, mais une occasion de mieux nous comprendre et de comprendre le monde que nous continuons de construire, notamment à travers la musique.
Enfin, vous avez le choix. Vous pouvez écouter – et donc soutenir – les artistes qui tentent de donner une nouvelle orientation au rap : plus engagée, plus inclusive, capable de mieux exprimer la complexité du présent sans la réduire à la violence ou à l’oppression. Chaque écoute est une forme de soutien et de participation : décider qui mérite notre attention, c’est aussi imaginer le type de culture que nous souhaitons voir se développer.
Luce