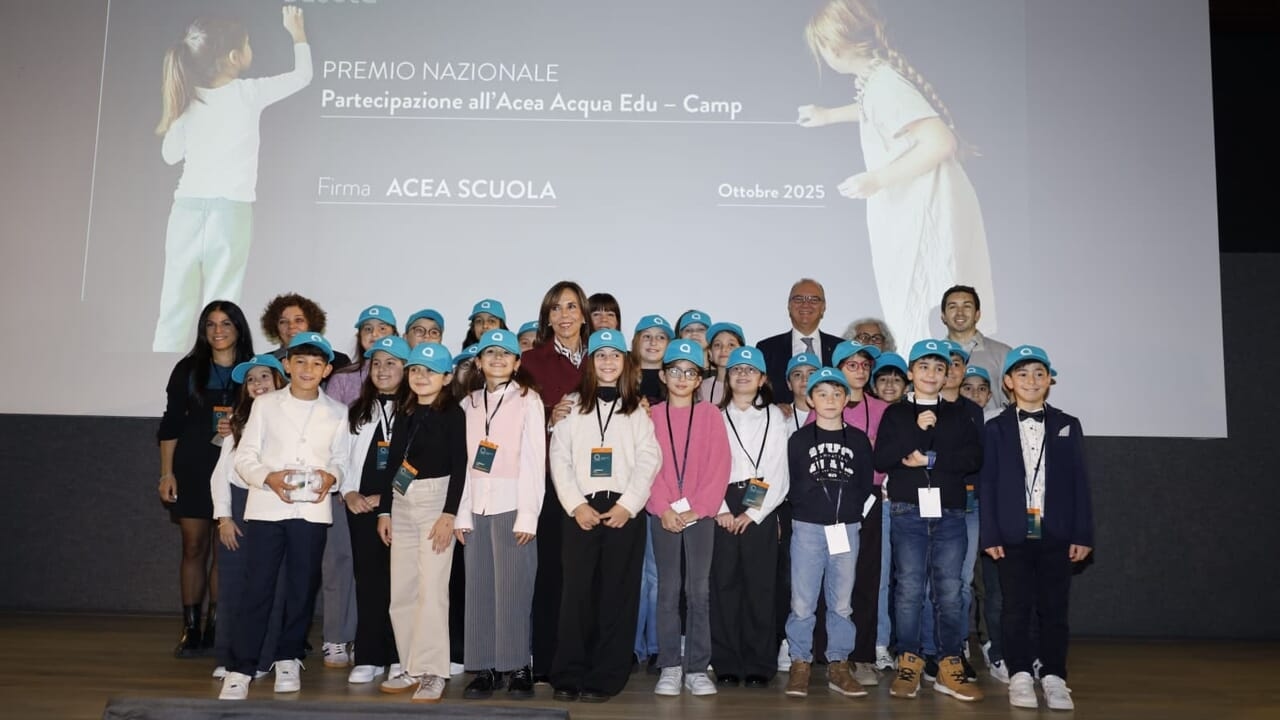Belen Rodríguez et ses ex « battus ». La violence inversée n'a rien d'amusant et ne change rien à la nature des abus.

Lors de l'interview avec Belve , Belen Rodríguez Elle a raconté avec une aisance désarmante avoir « tabassé » tous ses ex . Une phrase prononcée presque pour détendre l'atmosphère, entre rire et clin d'œil, mais qui soulevait un problème bien plus grave qu'il n'y paraît à la télévision. Ce n'est pas la première fois qu'une personnalité publique féminine admet avoir eu un comportement violent : l'année dernière, Loredana Bertè , dans la même émission, avait également relaté des épisodes similaires, avec la même franchise.
Pourtant, derrière la sincérité ou la spontanéité de certains aveux se cache une question importante : que se passe-t-il lorsque la violence est inversée dans son sens, mais pas dans sa logique ?
La violence « à rebours » n'est pas la libération.Depuis des siècles, la violence masculine fait partie intégrante des rapports de pouvoir , notamment au sein des relations . Elle constitue le moyen le plus direct – et le plus dévastateur – par lequel le patriarcat exerce son emprise. À titre d' exemple, selon l'ISTAT, en Italie , 31,5 % des femmes âgées de 16 à 70 ans ont subi au moins une fois dans leur vie des violences physiques ou sexuelles . Pour 3 millions d'entre elles (soit 13,6 % des Italiennes), ces violences ont été perpétrées par leur conjoint actuel (5,2 %) ou leur ex-conjoint (18,9 %).
Il est donc clair que lorsqu'une femme commet des violences, qu'elles soient physiques ou symboliques , elle le fait dans un contexte totalement différent : il n'y a ni égalité de pouvoir, ni histoire d'oppression commune. Mais cela ne rend pas l'acte acceptable, ni même libérateur. Reproduire la logique du coup – « J'ai été blessée, alors je frappe » – ne subvertit pas le modèle toxique, cela ne fait que le confirmer. Inverser les rôles ne renverse pas le système, cela le consolide.
Il ne s'agit pas ici de la légitime défense de celles et ceux qui réagissent pour se protéger d'abus ou d'une menace réelle, mais plutôt des comportements qui prennent la forme de vengeance ou d'oppression . Il ne s'agit pas d'assimiler la violence masculine et la violence féminine — qui ont des origines, une fréquence et des conséquences très différentes —, mais de reconnaître que toute forme d'agression intentionnelle reproduit un modèle relationnel qu'il convient de dépasser.
Dans son ouvrage « Of Woman Born », l'écrivaine et poétesse Adrienne Rich soutient que la colère des femmes n'est pas un problème à résoudre, mais une énergie à comprendre et à transformer. Pour Rich, cette force émotionnelle, souvent perçue comme destructrice ou excessive, peut devenir le point de départ d'un changement politique et personnel , à condition qu'elle ne se mue pas en vengeance ou en ressentiment.
« La colère, lorsqu'elle est exprimée et mise en œuvre au service de notre vision et de notre avenir, est un acte libérateur et émancipateur », explique Rich. Dans cette optique, la colère ne doit pas être refoulée, mais elle ne doit pas non plus se manifester par la violence : elle doit se transformer en prise de conscience, en paroles, en actions qui ne reproduisent pas ce que nous voulons changer. C'est précisément cette transformation, et non une réaction identique, qui confère à la colère son caractère politique et libérateur.
La culture du geste et le risque de spectacularisationDans une société qui transforme tout en contenu, même la violence peut devenir un spectacle . Lorsqu'une femme célèbre admet avoir levé les mains et que la réaction collective mêle amusement, curiosité et soulagement (« enfin quelqu'un qui dit la vérité ! »), le message véhiculé est ambigu : la violence peut être un signe de caractère, une épreuve de force, voire d'authenticité.
C'est un court-circuit culturel : d'un côté, nous condamnons la violence masculine, de l'autre, nous applaudissons la violence féminine comme s'il s'agissait d'un acte de rébellion . Mais l'émancipation ne signifie pas adopter les codes du pouvoir qui nous ont fait du mal ; elle signifie au contraire les rejeter .
La véritable émancipation ne résulte pas de la reproduction des mêmes schémas de pouvoir, mais de la recherche de nouveaux. Un autre mode de relation est nécessaire : fondé sur le respect mutuel, l’écoute et la capacité à gérer la colère sans la transformer en agression. Dire « Je refuse d’être soumis » ne signifie pas répondre par la même violence, mais plutôt se libérer de cette logique.
Luce