Le président de la République est-il le patron des maires, comme l’affirmait Gustavo Petro dans le Cauca ?

Le président Gustavo Petro est de nouveau au cœur du débat après avoir déclaré, lors d'une manifestation publique dans le département du Cauca , qu'il était le « patron des maires » du pays. Cette déclaration intervient dans un climat de confrontation avec les autorités locales, notamment les maires et les gouverneurs.
« Aujourd'hui, le maire de Cali m'a adressé ses salutations. Tous les véhicules blindés de l'armée sont arrivés pour protéger Cali, et il a dit : "Merci, ministre de la Défense." Point final. Ha ! Ils ne veulent pas de Petro. Je suis le chef du maire et le chef de l'armée. Je suis le chef du maire, le chef de l'armée. Blanc, ils ne veulent pas de Petro », ont déclaré le président Petro.
Ces déclarations font suite à un message publié par le maire de Cali, Alejandro Eder, sur son compte X. Le dirigeant local y a remercié le ministre Pedro Sánchez pour l'arrivée des véhicules blindés Hunter TR-12 dans la capitale du Valle del Cauca pour renforcer la sécurité, suite à l'attaque du 21 août près de la base aérienne Marco Fidel Suárez.
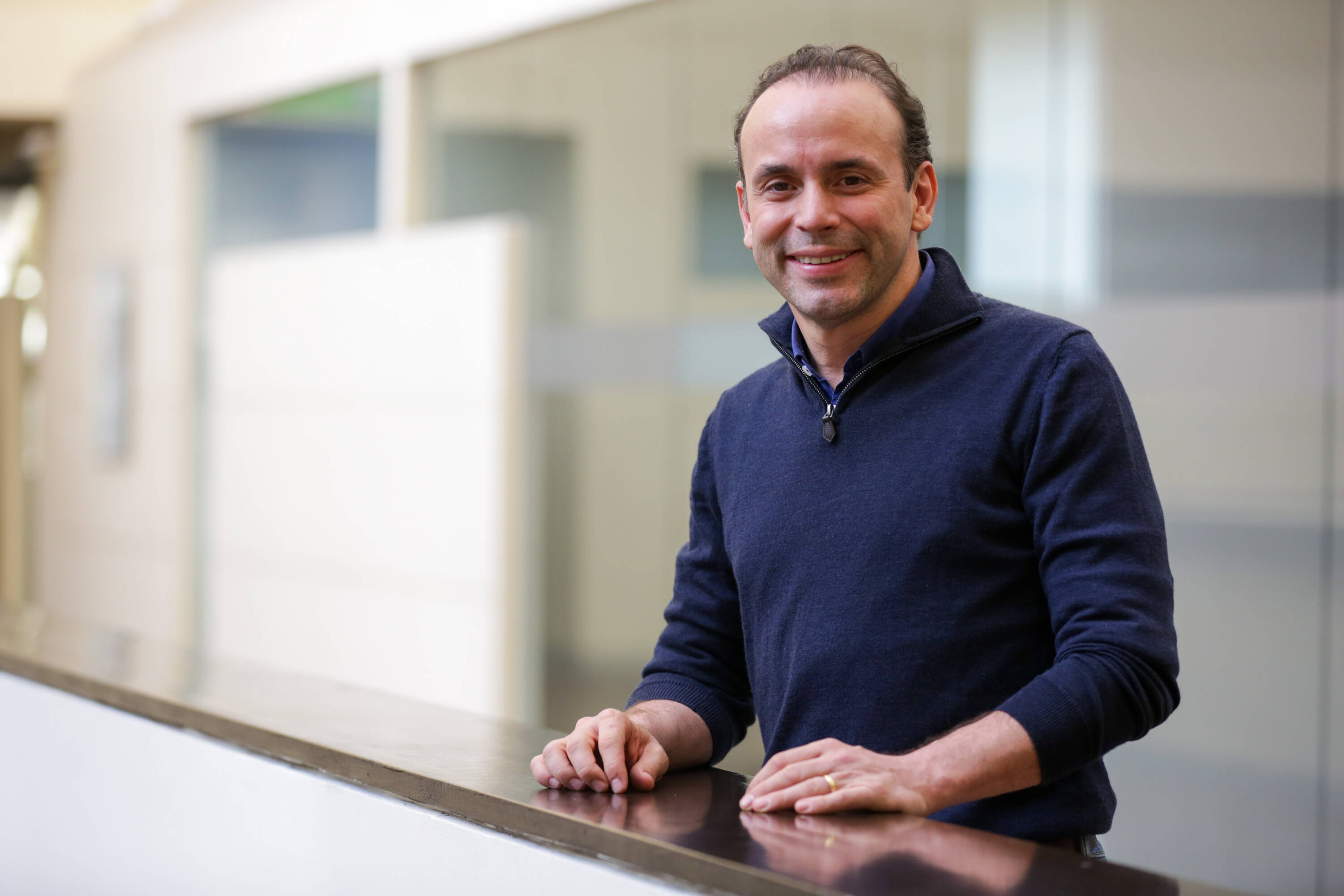
Alejandro Eder, maire de Cali. Photo : César Melgarejo. Le Temps
« Mon cher maire, j'apprécie votre gratitude envers le ministre de la Défense et le gouvernement. Le gouvernement, constitutionnellement, est composé du président et du ministre du secteur, ne l'oubliez pas. N'ayez pas honte », a écrit Petro sur un ton de reproche, quelques heures avant son discours.
Ces propos ont déclenché un vif débat sur l'étendue de l'autorité présidentielle vis-à-vis des élus locaux, quelques jours seulement après son affrontement avec Federico Gutiérrez, maire de Medellín, au sujet de son voyage à Washington. Cette déclaration soulève une question fondamentale : que dit réellement la Constitution sur la relation entre le président et les maires ?
Selon la Constitution politique de 1991, les maires sont élus au suffrage universel et constituent la plus haute autorité administrative de leur commune (article 315). Ils jouissent ainsi d'une autonomie politique, fiscale et administrative, fondée sur le principe de décentralisation établi à l'article 1 de la Constitution.
Bien que le Président de la République soit chef de l’État, chef du gouvernement et autorité administrative suprême, cela ne fait pas automatiquement de lui le supérieur hiérarchique des maires.
« Les collectivités territoriales jouissent de l'autonomie dans la gestion de leurs intérêts, dans les limites de la Constitution et de la loi. À ce titre, elles disposent des droits suivants : s'administrer elles-mêmes par leurs propres autorités ; exercer les compétences qui leur sont propres ; administrer les ressources et établir les impôts nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions (...) », stipule l'article 287 de la Constitution.
Pour l'analyste politique Carlos Arias, il est essentiel de préciser que les maires sont ceux qui ont le pouvoir de gérer les ressources de leurs municipalités, ainsi que celles des villes et des gouvernorats.
« En ce sens, la déclaration du président est grave, car soit il ignore la Constitution, soit, en toute connaissance de cause, il lance ce type de diatribe qui finit par semer la confusion dans l'opinion publique et, surtout, par manquer de respect à l'autonomie administrative des maires et des gouverneurs », a-t-il souligné.

Federico Gutiérrez, maire de Medellín. Photo : Javier Nieto Álvarez. Le Temps
Cela ne signifie toutefois pas que les décisions nationales soient distinctes de ce qui se passe au niveau des départements et des municipalités. Le pouvoir exécutif établit les orientations et les politiques publiques que les municipalités doivent coordonner, par exemple en matière de sécurité. Cependant, la relation est toujours axée sur la coordination et l'articulation, et non sur la subordination.
« De la part du gouvernement national, Monsieur le Président Petro. Santos était-il votre supérieur en tant que maire ? Non. Le président doit coordonner et coopérer avec les maires et les gouverneurs, mais vous n'êtes ni leur supérieur ni celui des entités territoriales », a déclaré la sénatrice Angélica Lozano au milieu de la polémique.
La Fédération colombienne des municipalités, pour sa part, a cité la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et du Conseil d'État, qui a confirmé l'autonomie des maires dans les décisions locales. Elle a mentionné l'arrêt du Conseil d'État de 2018, qui a refusé le droit de faire appel de ses décisions devant une autorité supérieure, et l'arrêt C-643 de la Cour de 1999, qui a reconnu sa compétence exclusive sur le domaine public municipal. À cet égard, la Fédération a souligné que le respect de l'autonomie territoriale est essentiel à la gouvernance locale et au renforcement de la démocratie en Colombie.
Mais a-t-il jamais été aussi vrai que le prétend Petro ? Avant la promulgation de la Constitution de 1991, la Colombie disposait d’un système plus centralisé : les maires étaient directement nommés par les gouverneurs, eux-mêmes nommés par le président.
Tout a changé en 1986, lorsque la loi 01 a été adoptée sous le gouvernement de Belisario Betancur , instaurant l'élection populaire des maires. L'étape décisive a eu lieu en 1991, lorsque la nouvelle Constitution a stipulé que les maires et les gouverneurs devaient être élus au suffrage universel. La déclaration de Petro aurait donc eu du sens dans la Colombie d'avant la décentralisation, mais plus aujourd'hui.
Un débat similaire a éclaté en mai 2023, lorsque Petro a affirmé être le supérieur hiérarchique du procureur général de l'époque, Francisco Barbosa. Puis, s'appuyant sur la Constitution, il a fondé sa revendication sur l'article 115, qui stipule que le président de la République est « chef de l'État, chef du gouvernement et autorité administrative suprême ».
Plusieurs analystes, organisations, hommes politiques et anciens juges ont réfuté cette interprétation, soulignant que, même si Petro est le chef de l’État, cela ne le rend pas supérieur aux deux autres pouvoirs du gouvernement : le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif.

Petro a eu un accrochage similaire avec l'ancien procureur Francisco Barbosa. Photo : Bureau du procureur général
« L'article 113 de la Constitution établit que les pouvoirs publics sont le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Le gouvernement, par rapport au pouvoir judiciaire, dispose de certains pouvoirs qui n'ont rien à voir avec une supériorité entre eux. Le ministère public fait partie du pouvoir judiciaire et jouit d'une autonomie administrative et budgétaire. Par conséquent, il est faux de prétendre que le président est le supérieur du procureur général », avait déclaré à l'époque Alfredo Gómez Quintero, ancien juge de la Cour suprême.
CAMILO A. CASTILLORédacteur politiqueX: (@camiloandres894)
eltiempo





